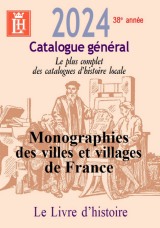Samedi 20 avril 2024
Collection principale
Collection fondée en 1987
sur le Net depuis 1997
Recherche d'un ouvrage
NOS AUTRES COLLECTIONS...
et encore...
et enfin...
Anthologie sonore (CD)
Informations
MERVILLE (Histoire de la Baronnie de)
 | Par l'abbé Larrondo Référence : 1893 Date édition : 2003 Format : 14 X 20 ISBN : 2-84373-273-5 Nombre de pages : 614 Première édition : 1891 Reliure : br. Prix: 68.97€ |
Difficile aujourd'hui, pour les visiteurs du château de Merville, situé à une vingtaine de kilomètres, à l'ouest de Toulouse, d'imaginer les circonstances étonnantes dans lesquelles cette belle demeure seigneuriale fut édifiée, de 1743 à 1759 : 300 000 briques furent nécessaires pour sa construction, il fallut déplacer les habitants du village, raser leurs maisons, ainsi que les deux vieux châteaux et combler les douves ; quant à la réalisation du parc, de près de 30 hectares, elle était si ambitieuse « qu'il fallut attendre notre époque pour le voir achevé » : large allée de 600 m, bordée de pins parasols, labyrinthe de buis sur une surface de 4 hectares, avec une véritable architecture de la végétation et des ronds-points en étoile qui aboutissent à « une salle de bal ». Cette histoire dans l'histoire de la baronnie de Merville donne une idée de l'aspect grandiose et mouvementé de son passé. D'autant que l'abbé Larrondo le retrace depuis ses origines très anciennes (gallo-romaines) jusqu'à la Révolution. Dans ce récit, il fait une large place au village de Merville lui-même, à ses différents noms (Omerville ou Homerville jusqu'au XIe siècle), au serment de fidélité fait au roi (1271) par ses notables et ses consuls et aux événements tragiques qui marquèrent la cité (sac et destruction par les Anglais au XIVe siècle, puis reconstruction), siège de Merville (1594) et destruction de l'enceinte fortifiée (1734).
Les privilèges et les coutumes ne sont pas oubliés : la liberté communale, les punitions et les amendes, la transaction des affaires et les franchises particulières (construction de fours sur le territoire, chasse aux lièvres, aux loups et aux renards, droits sur l'hôpital pour tous les consuls...). Quant aux discordes entre les vassaux et les seigneurs, elles sont longuement évoquées (transactions de 1416, 1603, 1605, 1609, 1734), ainsi que l'administration de la ville confiée au seigneur et aux consuls, mais partagée aussi par le syndic et les assemblées publiques, le notaire et le bailli, le lieutenant juridictionnel et l'instituteur (école primaire dès le XIIIe siècle). En 1306, Philippe le Bel donne la seigneurie à Bertrand Jourdain de l'Isle (premier seigneur de Merville) et à sa maison succèderont celles de Pérusse des Cars, de Chalvet-Rochemonteix, de La Fîte-Pelleport et de Villèle (Henri-Louis, comte de Villèle, propriétaire des lieux, étant le fils du célèbre ministre de Louis XVIII et Charles X, auteur, par ailleurs, de Mémoires passionnants). Enfin, après avoir décrit en détail le château qui est, depuis le XVIIIe siècle, le plus bel ornement de Merville, l'abbé Larrondo relate l'histoire de la paroisse (avec ses curés, ses confréries et l'abbaye de Notre-Dame de la Capelle, de l'ordre de Prémontré), terminant par un appendice important intitulé Merville pendant la Révolution.© Micberth
11:06
RECHERCHE
Mon panier 
LA FEUILLE PÉRIODIQUE
Nos principaux libraires
Adresses utiles
LORISSE
Place du Château
02250 AUTREMENCOURT
à Paris
(courrier exclusivement)
67, Rue Saint-Jacques
75005 Paris

Service libraires :
Virginie Beaufils
Tél : + 33 (0)3 23 20 26 31
lorisse@wanadoo.fr

HISTOIRE LOCALE
2, Petite Rue
02250 AUTREMENCOURT

Service clients :
Annick Morel
Tél : +33 (0)3 23 20 32 19
livre-histoire@wanadoo.fr

Virginie Micberth








 BOULIEU AUTREFOIS. La fondation du couvent des religieuses ursulines en 1632
BOULIEU AUTREFOIS. La fondation du couvent des religieuses ursulines en 1632