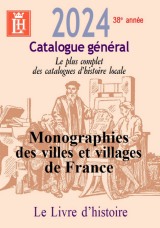Vendredi 19 avril 2024
Collection principale
Collection fondée en 1987
sur le Net depuis 1997
Recherche d'un ouvrage
NOS AUTRES COLLECTIONS...
et encore...
et enfin...
Anthologie sonore (CD)
Informations
HAMBYE (Histoire de). Vol. II L'abbaye
 | Par Eugène Niobey Référence : 3529 Date édition : 2019 Format : 14 X 20 ISBN : 978-2-7586-1049-6 Nombre de pages : 232 Première édition : 1940 Reliure : br. Prix: 30.00€ |
Dans ce volume, l'auteur ramène l'attention « sur la chère abbaye de notre petite région, premier charme artistique de notre enfance ». Classée aujourd'hui monument historique, l'abbaye, fondée au XIIe siècle sur les bords de la Sienne par Guillaume Painel (selon l'orthographe adoptée par l'auteur), seigneur de Hambye, sera bâtie en l'espace de 120 ans. Sous l'impulsion des « moines gris » de la congrégation de Tiron dans le Perche, elle connut alors une période florissante et accueillit des bénédictins jusqu'à la Révolution avant d'être partiellement détruite. « L'aumône, avec le travail et la prière, était le devoir et la raison d'être des moines ». Ils coûtaient peu et avaient le droit de prendre leur retraite au couvent, d'y mourir et d'occuper une place dans le cimetière du cloître. L'architecture de l'abbaye reflète l'évolution des styles. Les bâtiments conventuels furent restaurés au XVe siècle, puis remaniés au XVIIIe siècle par les abbés commendataires. Les revenus de l'abbaye venaient du travail gratuit des moines, des revenus des fidèles et des dons des fondateurs notamment, comme ceux des familles Painel et d'Estouteville. Á Hambye, comme dans beaucoup de lieux semblables, c'est le temps qui a ruiné l'abbatiale, parce que les hommes l'ont abandonnée, faute de vocations. En 1739, on comptait 5 moines dans le monastère bâti pour en abriter 30. En 1758, il ne restait plus qu'un prieur et plus personne en 1786 ; l'abbé habitait Paris. L'Assemblée nationale vendra le monastère en 1791 mais « réservera » l'église abbatiale dans le but d'en faire une annexe pour le culte. Cette dernière sera vendue en 1810, sous l'Empire, pour être démolie pierre par pierre. Á l'initiative des Amis de l'abbaye de Hambye, des fouilles furent entreprises au printemps 1932. Le 19 juillet 1933, sous la pioche prudente des ouvriers apparut un sarcophage de pierre blanche au milieu géométrique du chœur. Deux squelettes seront identifiés comme étant ceux de Jeanne Painel et de Louis d'Estouteville, son mari, qui défendit le Mont-Saint-Michel contre les Anglais. Parmi les filiales de l'abbaye à l'époque où elle fut établie « chef d'ordre » par le Pape, trente ans après sa fondation, citons celle de Valmont, berceau de Louis d'Estouteville, ou encore celle de Longues, dans le Calvados.© Micberth
01:13
RECHERCHE
Mon panier 
LA FEUILLE PÉRIODIQUE
Nos principaux libraires
Adresses utiles
LORISSE
Place du Château
02250 AUTREMENCOURT
à Paris
(courrier exclusivement)
67, Rue Saint-Jacques
75005 Paris

Service libraires :
Virginie Beaufils
Tél : + 33 (0)3 23 20 26 31
lorisse@wanadoo.fr

HISTOIRE LOCALE
2, Petite Rue
02250 AUTREMENCOURT

Service clients :
Annick Morel
Tél : +33 (0)3 23 20 32 19
livre-histoire@wanadoo.fr

Virginie Micberth








 BOULIEU AUTREFOIS. La fondation du couvent des religieuses ursulines en 1632
BOULIEU AUTREFOIS. La fondation du couvent des religieuses ursulines en 1632